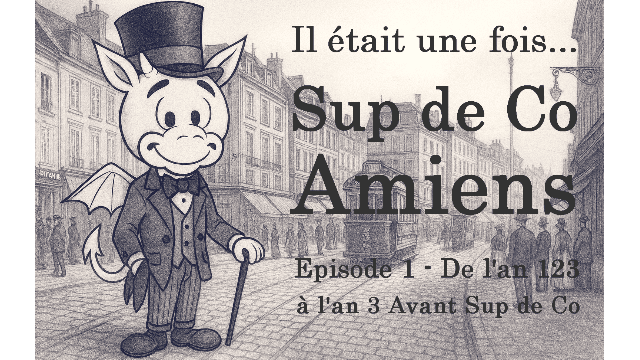Il était une fois Sup de Co Amiens... de l'an 123 à l'an 3 avant Sup de Co !
Quand les écoles de commerce cherchaient leur place
Vous le savez, ou vous l'apprenez, L'ESC Amiens a vu le jour en 1942. Nous y reviendrons bientôt avec moult détails mais il me semblait important de vous proposer d'abord un résumé de ce qui s'est passé avant, depuis 1819 si l'on prend pour point de départ la création de l’École Spéciale de Commerce et d’Industrie – future ESCP.
Alors laissez donc Théo notre chère Gargouille et votre serviteur vous conter ce que furent les écoles de commerce depuis cette date, 123 ans avant l'avènement de l'ESC Amiens, un épisode 1 qui nous emmènera jusqu'à ces funestes jours de septembre 1939. 🌩️
Le moins que l'on puisse dire, c'est que les premières années, les premières décennies, furent... comment dire ?... compliquées... Et vous allez le voir, assez étonnamment, quoi que... 😏, des difficultés qui parfois ne semblent pas très éloignées de ce que l'on entend ces dernières années à propos de certaines écoles en termes d'intérêt, de légitimité, de niveau, de coût... 💶
Alors comment on sait cela ? En grande partie grâce à l'extraordinaire travail que représente une thèse soutenue par Marianne BLANCHARD en 2012 sous la direction de Stéphane BEAUD et la co direction d'André GRELON devant l'ÉCOLE DES HAUTES ÉTUDES EN SCIENCES SOCIALES : "Socio-histoire d’une entreprise éducative : Le développement des Écoles supérieures de commerce en France (fin du XIXe siècle - 2010)". Un impressionnant travail de 565 pages et 99 pages d'annexes ! Nos Alumni enseignant chercheurs, comme Philippe DURANCE, savent ce qu'il en coûte d'investissement et de travail de fond. J'ai tout lu, que dis-je, dévoré... Et nous y ferons référence à bien des reprises tout au long du présent épisode et de ce ceux à venir.
Ainsi donc, les premières écoles trouvèrent leurs origines dans une poignée d’initiatives locales menées par des négociants. L'ESCP aurait été la première en France voire dans le monde. Elle ambitionnait de donner une formation un peu plus structurée aux fils de commerçants et d’industriels qui, jusque-là, apprenaient surtout « sur le tas ». A l'évidence, cela n'a pas entrainé immédiatement un vaste mouvement et plutôt bien des interrogations sur l'intérêt et la pertinence de la démarche.
L'image discutée et discutable du commerce
N'étant ni historien et encore moins chercheur, tout au plus assisté d'une gargouille 😅 , vous m’accorderez de temps à autre de vous soumettre quelques opinions. Ainsi, je crois volontiers qu’en France, pays de traditions judéo-chrétiennes, le rapport au commerce et plus particulièrement à l’argent a toujours été ... délicat ?... Le mercanti n’est jamais loin du marchand 🫤 … Et vous noterez que des dizaines d’années plus tard, ces pauvres prépas commerciales étaient surnommées les épices… pour épiciers… C'est dire la considération limitée que devait susciter l'émergence de ces établissements. 🙄
Des écoles locales, aux ambitions limitées
Quoi qu'il en soit, à la fin du XIXᵉ siècle, on voit émerger ici et là quelques unes de ces nouvelles écoles dédiées à l'enseignement du commerce : Bordeaux (1873), Marseille (1881), Rouen et Le Havre (1890), Lille (1894), Dijon (1898)... Entre-temps, sont entrées dans la danse les chambres de commerce qui commencent à se soucier de doter leur territoire d’outils de formation. Les missions de ces écoles restent modestes, ou disons, adaptées aux besoins territoriaux. On y forme des comptables, des agents d’exportation, des employés bilingues : l'heure n'est pas encore aux cadres dirigeants des plus grandes entreprises, aux financements structurés, aux partners, encore moins au coaches et Michael Porter n'est pas né ! 😅
Comme l'expose Marianne BLANCHARD dans sa thèse, ces établissements sont marqués par une triple « illégitimité, sociale, académique et administrative » [1], que l'on peut décrire comme de « petits établissements, peu sélectifs, peu reconnus et au recrutement essentiellement régional » [2], parfois stigmatisés comme des « écoles refuges pour fils à papa » [3]. 😦
Autrement dit, ni le prestige, ni la sélectivité, ni la reconnaissance de l’État, à de rares exceptions près, tout ce qui en résumé définit et caractérise les « grandes écoles », rien n'est franchement au rendez-vous. La route vers la place que ces écoles peuvent prétendre occuper aujourd'hui va être longue. 😰
Le dernier choix du « bon élève » ?
En ces temps anciens, les bons élèves pour ne pas dire les meilleurs ont pour premier objectif de décrocher le baccalauréat. Il faut rappeler ce qu'il en est alors ; le « bachot » n’avait rien de démocratique : à peine 2 % d’une classe d’âge obtenaient ce diplôme dans sa totalité [4].
Un bon élève se tournait vers médecine, le droit, une école d'ingénieur... Une école de commerce ???!! Seigneur Marie Sainte Mère de Dieu, que l'on nous en préserve !!! 😂 Même les commerçants locaux se demandaient pourquoi aller payer une école quand la famille était là pour former les rejetons à la reprise des affaires. 😵
On ne saurait vraiment parler de concours : les classes préparatoires commerciales au sens moderne n’existent pas encore. On voit toutefois apparaître des préparations locales (notamment à Paris, la Chambre de commerce de Paris ayant ouvert une préparation commerciale dès 1886), sans commune mesure avec les CPGE d’aujourd’hui. En dehors de ces initiatives, il semble bien que la détention du bachot complet dispensait les candidats de toutes épreuves écrites dans la plupart des cas. A défaut, la sélectivité n'était pas des plus élevée. Les écoles peinaient à remplir leurs effectifs, elles rechignaient donc à se montrer plus exigeantes de peur de perdre des élèves. On pouvait ainsi entrer dans une ESC dès 15 ans, bien souvent sans aucun diplôme, et les études ne duraient que deux ans. Etonnant non !? 😉
C’est dans ce contexte qu’est apparu HEC Paris en 1881, avec une ambition différente. La Chambre de Commerce de Paris voulait se doter d'un établissement qui devait faire la différence, y compris avec l'ESCP : il fallait se doter d'une école qui serait au commerce ce que Centrale était à l'ingénierie. C'est ainsi qu'il fut décidé qu'il fallait avoir 17 ans pour se présenter[5]. Puis HEC instaura un concours (1892), supprimé en 1906 avant d'être rétablit en 1913, c'est dire si le terrain était mouvant. Mais la volonté d'élever progressivement les exigences est bien là, avec le modèle des écoles d’ingénieurs en ligne de mire. Coup de génie marketing en terme de positionnement, il sera décidé fût une époque qu'il fallait être diplômé d'une ESC pour rentrer à HEC ! 🤩 143 ans plus tard, l'autre super coup d'HEC fut de recruter Bruno COLLACHE, ESC Amiens 91 et ex président des Alumni, comme directeur financier mais c'est un autre sujet ! 😅
Au tournant du XIXème siècle
Le mouvement de création d’écoles se poursuit : Nantes (1900), Toulouse (1902) viennent s’ajouter à la liste. Les chambres de commerce de plus en plus engagées dans l'administration de ces écoles avancent dans l'idée qu'il s'agit là d'un atout local, d'une vitrine économique et d'un outil de formation pour leurs jeunes recrues.
Mais, point de faiblesse notable déjà à l'époque, les corps enseignant comptent beaucoup de vacataires, parfois quelques universitaires sollicités ponctuellement ; on est loin de véritables corps enseignant stables et reconnus. Rien de comparable avec les écoles d’ingénieurs où l’État encadre les programmes et soutient les enseignants, leur conférant un prestige académique supérieur.
En 1902, une tentative d’unification voit le jour à travers un premier concours commun réunissant HEC, l’ESC Paris et plusieurs ESC de province (Bordeaux, Dijon, Le Havre et même Alger !). L'expérience éclaire cruellement l'écart entre Paris et la province : 235 candidats pour HEC, 119 pour l'ESC Lyon, 69 pour Bordeaux, 47 pour Dijon, 33 pour Le Havre [6]... .
Cet élan encore hésitant en ce début de siècle sera brutalement interrompu par la Première Guerre mondiale. Beaucoup d’écoles ferment temporairement ou voient leurs étudiants mobilisés. Même l'ESSEC ne compta plus qu'une poignée d'élèves au point de fermer provisoirement en 1914 avant d'ouvrir à nouveau ses portes en 1915 ! 😦
Au sortir de l'Armistice : un entre-deux fragile
En 1918, lorsque la guerre s’achève, les écoles de commerce rouvrent tant bien que mal. Les promotions sont réduites : certains élèves et professeurs ont disparu au front, les locaux ont parfois souffert et l’argent manque. Mais l’idée que l’économie moderne a besoin de cadres formés a poursuivi son chemin.
Dans les années 1920, les effectifs augmentent légèrement... Cela reste modeste : on compte rarement plus de 20 à 40 diplômés par an dans une ESC. Rien à voir avec les universités de droit ou les grandes écoles d’ingénieurs.
Le contenu des enseignements demeure très hétérogène. Certaines écoles enrichissent leurs programmes de langues vivantes supplémentaires, de droit commercial ou d’économie politique ; d’autres se limitent encore à des matières très pratiques. Résultat : aucune homogénéité de niveau, aucune garantie de qualité nationale. Comme l’écrit Marianne BLANCHARD dans sa thèse, les ESC restent alors des « établissements fragiles, au recrutement modeste et à la reconnaissance incertaine » [7].
Au cours des années 20, on voit émerger des associations d'anciens élèves à Bordeaux, Marseille ou Dijon. Leur but ? Défendre la valeur du diplôme auprès des employeurs, pousser à plus de reconnaissance académique. Des démarches que l'on rangera plutôt du côté des forces centripètes, dans le sens où ces associations cherchent à tirer les réseaux vers le haut et s'ouvrent à leur rapprochement. On en trouvera l'héritage dans une association des anciens élèves commune à l'ensemble des ESC dans les années 70/80. Si, si, cela a existé, on y comptait même l'ESC d'Alger ! 😳
Mais les tenants des forces centrifuges, qui privilégient les intérêts locaux, ne manquaient pas d'arguments et il est probable que c'est surtout l'argent qui manquait parmi les chambres de commerce qui finançaient et géraient les écoles et qui hésitaient à investir davantage..
Le contraste avec les écoles d'ingénieurs
Soutenues de longue date par l’État, portées par la révolution industrielle, sans parler des intérêts stratégiques et militaires, faut-il rappeler que Polytechnique dépend du Ministère des Armées, les écoles d'ingénieurs offrent un paysage tout autre.
L'École des Ponts et Chaussées est là depuis 1747 ; celle des Mines de Paris depuis 1783. Polytechnique, créée en 1794, comptait déjà environ 250 élèves par promotion au XIXᵉ siècle, les Arts et Métiers fondés en 1780 comptaient plus de 1 000 élèves au tournant du XXᵉ siècle.
Ces écoles incarnent la modernité industrielle, adossées à l’État, garantes de diplômes prestigieux. Elles bénéficient d’un ancrage ancien, d’une sélectivité forte, d’une reconnaissance nationale.
Face à elles, les ESC paraissent des institutions périphériques, sans comparaison de moyens ni de prestige : elles se font d'ailleurs "chatouillées" par les écoles d'ingénieurs qui leur demandent en quoi elles seraient des écoles "supérieures"... Ouch... 😵
La crise des années 30 et la réforme de 1937
Lorsque survient la crise de 1929, la France se rend compte un peu plus encore qu’elle manque pourtant de cadres commerciaux et financiers à la hauteur d’une économie qui se mondialise et de la cohorte des nouveaux problèmes qui se présentent.... Les ESC vont devoir se transformer et comme souvent en France, cela prendra du temps avant que l'on ne puisse mettre sur la table une nouvelle réforme affichant une certaine envergure.
Cette réforme arrivera enfin en 1937 avec un décret qui impose une « marche forcée vers l’enseignement supérieur » [8] :
harmonisation des programmes
examen national de sortie
plus de place accordée aux langues, au droit, à l’économie.
Cette réforme, qui offre pour la première fois un cadre national commun, amorce la lente conquête de légitimité des écoles de commerce françaises. 🍾🎇
Mais, comme souvent en France, bis repetita, tout ne se passe pas sans heurt. Il faut dire que le contexte de la crise des années 30 met à mal les finances des établissements qui craignent toutes les mesures qui viendraient à écarter des candidats pour satisfaire aux nouvelles exigences. En réponse à cette "marche forcée", la Chambre de Commerce de Lille ira jusqu’à fermer son établissement en signe de protestation [9]. Et pour sortir des clichés, je vous vois venir 😉, l'école de Marseille était plutôt de celles qui réclamaient plus d'intervention de Paris.
On voit là se dessiner ce qui caractérisera longtemps le réseau des futures ESC, où se seront toujours affrontées ces forces centripètes, qui poussaient à l'unification, la centralisation et à l'harmonisation des offres et des acteurs, et ces forces centrifuges, marquées par les ancrages locaux et des intérêts plus spécifiques, souvent liés à l'économie locale.
La richesse, la prospérité de ces économies locales, leur trajectoire politique et économique, expliquent sans doute en grande partie ces écarts qui existeront et perdureront entre les ESC, même lorsqu'elles s'étaient retrouvées sous la bannière du réseau des ESCAE..
C'est bien beau tout cela mais Amiens alors ?… 🤨
En 1937, je ne sais pas vous dire s'il était déjà question de créer une école de commerce à l'occasion des diners mondains qui réunissaient peut-être le tout Amiens... 🧐
En revanche, il était très probable que l'on y parlait comme un peu partout en France de cette Allemagne et de son chancelier, de l'inquiétude, c'est une litote, qu'ils inspiraient dans toute l'Europe, 20 ans à peine après l'armistice de 1918.
Est-ce que l'on se doutait qu'inéluctablement, la guerre ferait son retour en 1939 ? Les historiens spécialisés seront d'un avis bien plus éclairé que le mien.
Toujours est-il que l'on allait voir une nouvelle école émerger quelque temps plus tard, une école qui allait devoir faire avec ce qu'il était advenu des écoles de commerce depuis 1819, leurs quelques forces et leurs nombreuses faiblesses...
Et pour modeste qu'elle serait, cette école aurait la particularité de naitre en réaction à l'Histoire avec un grand H, et probablement de prendre alors bien du monde à contrepied. Quelle idée d'aller créer une école en 1942 !?! 😬
Je n'irais pas jusqu'à écrire que se seraient manifestés là les premiers signes d'une école qui serait toujours un peu à part mais bon... 😉
C'est ce que nous essaierons de regarder à l'occasion du prochain épisode.
Christophe MATHIEU, ESC 89, conteur
Si vous avez manqué l'épisode pilote, c'est par ici.
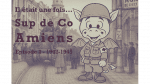
Commentaires0
Veuillez vous <a href="">connecter</a> pour lire ou ajouter un commentaire
Articles suggérés